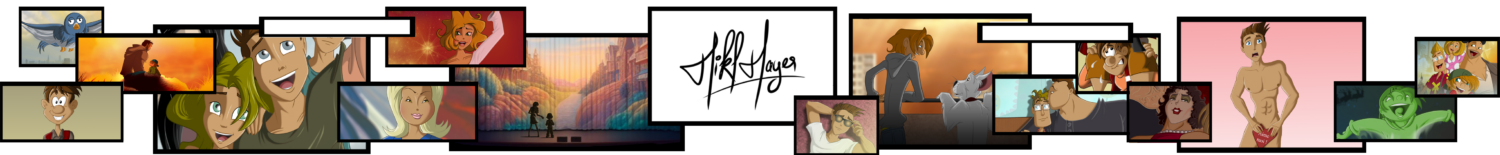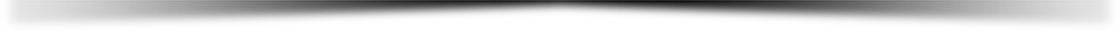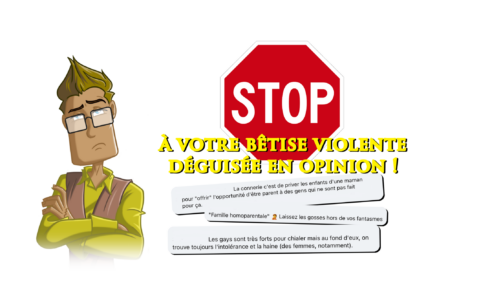Faut-il encore raconter des histoires, ou seulement cocher des cases ? La BD, entre diversité imposée et liberté créative, se retrouve prise dans la tempête du « wokisme ».
Le mot woke vient de l’anglais to wake (« s’éveiller »). Dans les années 1960, il désignait la conscience des injustices raciales au sein de la communauté afro-américaine. Dans les années 2010, il s’est élargi aux causes féministes, LGBT+ ou écologistes. Ses détracteurs en ont ensuite fait un terme péjoratif, synonyme de politiquement correct à outrance.
Quand la diversité divise
Ces dernières années, plusieurs BD ont cristallisé les débats. Peau d’homme de Hubert & Zanzim, fresque sur l’identité de genre à la Renaissance, a été saluée par la critique et primée à Angoulême, tout en étant jugée trop militante par certains lecteurs. Racines de Lou Lubie, qui explore le métissage et le racisme ordinaire, a connu un fort écho médiatique, mais a aussi suscité des réactions hostiles de ceux qui y voient une leçon plus qu’un récit. De son côté, Gender Queer de Maia Kobabe, autobiographie d’une personne non-binaire, est devenue l’une des BD les plus censurées aux États-Unis… ce qui n’a fait qu’amplifier ses ventes.
On pourrait citer également Fun Home d’Alison Bechdel ou La Rose la plus rouge s’épanouit de Liv Strömquist, deux succès critiques et commerciaux régulièrement accusés de transformer l’intime en manifeste. Fait notable : malgré les polémiques, toutes ces œuvres se vendent, se réimpriment, s’adaptent. La diversité divise, mais elle attire aussi un lectorat important, preuve qu’il existe une réelle demande pour ces récits.
Le spectre de la réécriture
La controverse ne concerne pas que les nouveautés. De nombreux classiques sont revisités à la lumière des sensibilités actuelles. Tintin au Congo est régulièrement critiqué pour sa vision coloniale et raciste : certains demandent son retrait des rayons, d’autres plaident pour une mise en contexte historique. Lucky Luke a vu disparaître sa cigarette, remplacée par un brin d’herbe, pour ne pas inciter les jeunes lecteurs au tabac. Même Astérix n’y échappe pas : certaines rééditions révisent des stéréotypes jugés offensants, en particulier sur les peuples représentés de manière caricaturale.
Ces ajustements divisent profondément. Pour les uns, il s’agit de rendre ces œuvres plus accessibles aux nouvelles générations. Pour les autres, c’est une trahison, une manière de réécrire l’histoire plutôt que de l’assumer. Car en modifiant le passé pour qu’il colle aux valeurs d’aujourd’hui, ne prend-on pas le risque de l’effacer ? L’art devient alors un terrain de correction permanente, au détriment de sa valeur patrimoniale et de sa sincérité originelle.
Disney, Netflix et Amazon, les cas d’école
Le cinéma et les plateformes ne sont pas épargnés, et ce n’est pas Disney qui dira le contraire. Dans Buzz l’Éclair, un petit bisou furtif entre deux femmes a provoqué un véritable séisme, allant jusqu’à entraîner des boycotts dans plusieurs pays. La Petite Sirène, avec une actrice noire dans le rôle d’Ariel, a suscité un débat mondial, tandis que Blanche-Neige a été pointée du doigt pour ses réécritures et des choix de casting jugés incohérents. Aucun de ces films n’a rencontré le succès espéré, mais réduire leurs résultats aux seules polémiques serait simpliste : lassitude du public face aux remakes, marketing maladroit et concurrence accrue ont aussi pesé.
Dans le même temps, Disney semble amorcer un virage plus prudent : un personnage transgenre a été retiré d’une série Pixar sur Disney+, et Elio, qui devait être gay dans sa première version, a vu ce trait gommé.
Netflix a, de son côté, multiplié les relectures « inclusives » dans ses séries et adaptations (Les Chroniques de Bridgerton, Sandman), tandis qu’Amazon Prime a essuyé de vives critiques avec Les Anneaux de Pouvoir pour sa diversité jugée artificielle dans l’univers de Tolkien. Là encore, le public se divise entre applaudissements et accusations de militantisme.
Un contre-exemple parmi d’autres
Certaines œuvres montrent pourtant que traiter de diversité n’implique pas forcément une démarche militante. La série Mes papas & moi de Mikl Mayer, créée bien avant que le terme « woke » ne devienne courant, aborde des thèmes comme l’homoparentalité ou la politique sans se revendiquer de ce mouvement.
De même, Le bleu est une couleur chaude de Julie Maroh, récit amoureux entre deux jeunes femmes, ou encore Fun Home d’Alison Bechdel, autobiographie intime, n’ont pas été conçus comme des manifestes, mais comme des histoires personnelles. Ces exemples rappellent que toutes les œuvres liées à la diversité ou aux identités ne relèvent pas d’un programme idéologique : elles peuvent simplement être le reflet d’un vécu ou d’un choix narratif.
Le vrai enjeu
La diversité en BD n’est pas une menace, elle enrichit l’art. Le danger surgit lorsqu’elle devient une obligation, un protocole imposé. La force d’une œuvre réside dans sa liberté : surprendre, déranger, émouvoir. Si la création se réduit à un discours attendu, elle perd son souffle.
La question n’est donc pas « faut-il de la diversité en BD ? », mais « laisse-t-on encore aux auteurs la liberté de créer sans consignes ? ».