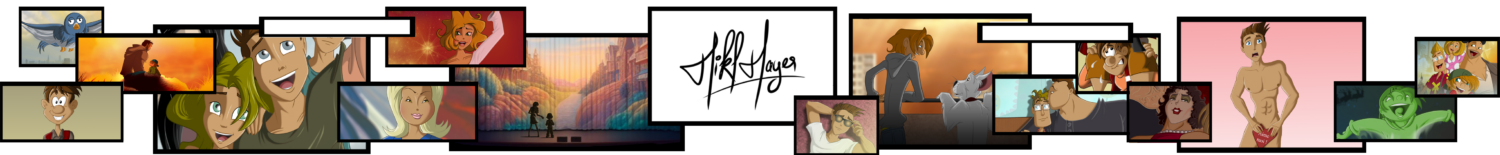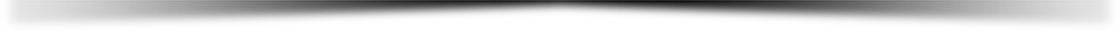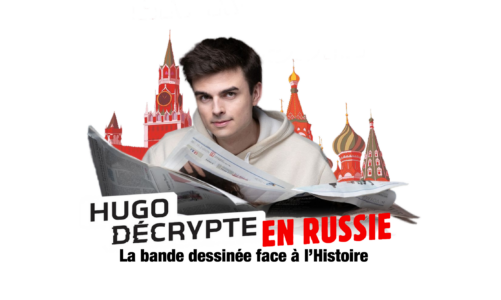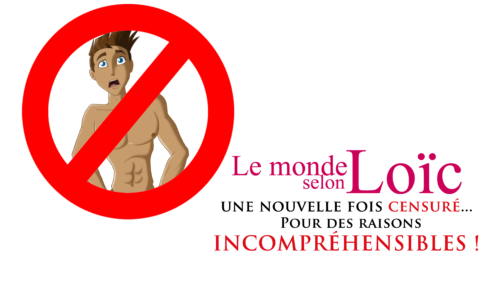La bande dessinée n’a jamais été qu’un simple divertissement. Derrière les bulles et les planches, les auteurs observent, questionnent et commentent leur époque. Et qu’on le veuille ou non, la politique s’y invite souvent — parfois discrètement, parfois avec fracas.
Bien avant d’être un art reconnu, la BD servait déjà d’arme satirique. Les caricatures de presse du XIXᵉ siècle — d’Honoré Daumier à Benjamin Rabier — dénonçaient les injustices sociales et se moquaient du pouvoir.
Puis vinrent les héros modernes : Tintin, Spirou, Astérix… Des personnages nés dans des contextes politiques précis. Tintin au pays des Soviets (1930) reflétait le climat anticommuniste de l’époque, tandis que Astérix le Gaulois utilisait l’occupation romaine comme miroir de la France gaullienne.
Quand la BD devient un miroir social
À partir des années 1970, la bande dessinée s’émancipe du simple divertissement. Les auteurs de Pilote, Métal Hurlant ou (À Suivre) font de leurs planches un espace d’expression politique.
Des thématiques comme la guerre du Vietnam, le féminisme ou l’écologie s’y imposent. Claire Bretécher, avec Les Frustrés, dresse un portrait mordant de la société post-soixante-huitarde. Plus tard, Titeuf ou L’Arabe du futur montrent comment le regard politique peut aussi passer par les yeux d’un enfant.
Satire, engagement ou simple reflet ?
Tous les auteurs ne cherchent pas à militer. Certains se contentent de traduire les tensions de leur époque. V pour Vendetta, d’Alan Moore, imagine une dictature qui résonne encore aujourd’hui. Persepolis, de Marjane Satrapi, raconte une révolution vécue de l’intérieur. Et Quai d’Orsay de Blain et Lanzac explore les coulisses du pouvoir avec un humour grinçant.
Entre satire et témoignage, la BD devient un langage politique universel, capable de dire l’indicible avec une efficacité que le texte seul n’atteint pas toujours.
La politique dans Mes papas & moi : Au fil des ans
Dans Mes papas & moi : Au fil des ans, la politique n’est pas seulement un décor, mais un véritable moteur narratif. À travers le personnage de Catherine, devenue figure publique et partisane de l’ouverture d’un centre de conversion, la série explore les dérives idéologiques et les manipulations de l’opinion.
Derrière son image lisse de mère modèle se cache une ambition politique nourrie de fanatisme religieux et de calculs électoraux. L’auteur s’en sert pour interroger la frontière entre conviction et opportunisme, foi et intolérance, tout en montrant comment le pouvoir peut se servir de la peur de l’autre pour exister. Cette dimension donne à la série une résonance contemporaine, rappelant que la politique, dans la BD comme dans la vie, est avant tout une affaire d’humains, de contradictions et de choix moraux.
Le pouvoir de la bulle
Ce qui rend la BD si puissante, c’est sa capacité à faire passer des messages complexes par le biais d’images simples. Une planche peut émouvoir, révolter, ou faire rire en une fraction de seconde.
Les auteurs contemporains, indépendants ou publiés en ligne, s’en emparent pour parler des droits humains, de la diversité, des crises écologiques ou des dérives populistes. La bande dessinée n’est plus en marge du débat : elle y participe pleinement.
Une nouvelle génération engagée
À l’instar de Mikl Mayer avec Le monde selon Loïc ou Mes papas & moi, de nombreux auteurs contemporains utilisent la bande dessinée pour aborder les enjeux de société avec sincérité et engagement. Leurs récits évoquent la diversité, l’égalité ou encore la liberté d’expression, en mêlant humour et émotion. Peau d’homme d’Hubert et Zanzim questionne les normes de genre et le poids des traditions, tandis que Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Pétrimaux dénonce, derrière son humour noir, la corruption et les dérives du pouvoir. Des autrices comme Mirion Malle (C’est comme ça que je disparais, Commando Culotte) explorent pour leur part la santé mentale et le sexisme à travers une approche à la fois intime et politique.
Quand la politique devient caricature
Impossible de parler de politique en bande dessinée sans évoquer la presse et son art de la caricature. De Charlie Hebdoau Canard Enchaîné, les dessinateurs ont depuis des décennies fait des hommes politiques leurs personnages récurrents, entre satire et critique sociale. Plantu, Cabu, Wolinski ou Charb ont chacun, à leur manière, transformé la caricature en langage citoyen. Loin d’être anodine, cette tradition a façonné la liberté d’expression à la française, rappelant que le dessin peut être un acte de résistance.
Dans le même esprit, certaines BD grand public ont détourné les codes du pouvoir avec humour. L’album J’aurais voulu être président en est un exemple marquant : il met en scène, avec ironie et tendresse, les ambitions, les ridicules et les contradictions du monde politique. Ces œuvres montrent que, qu’elle soit publiée dans un journal ou dans un album, la bande dessinée garde ce pouvoir unique de faire réfléchir en faisant sourire — et parfois grincer des dents.
Le 9ᵉ art, baromètre de son temps
Chaque époque a les bandes dessinées qu’elle mérite. Des caricatures politiques du XIXᵉ siècle aux webtoons militants d’aujourd’hui, la BD n’a jamais cessé de prendre parti, d’observer, de provoquer ou de réfléchir.
Qu’elle soit drôle ou dramatique, engagée ou simplement humaine, elle reste un formidable témoin de nos débats, de nos doutes et de nos espoirs.