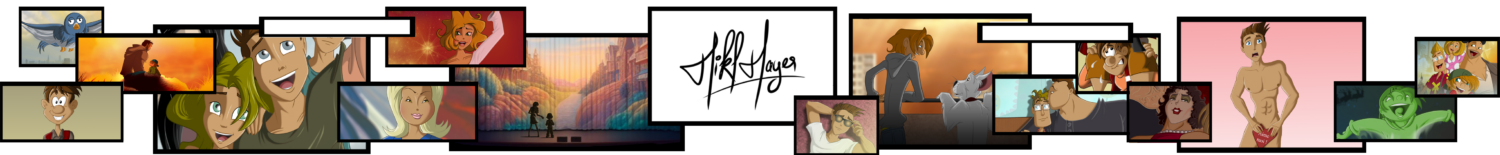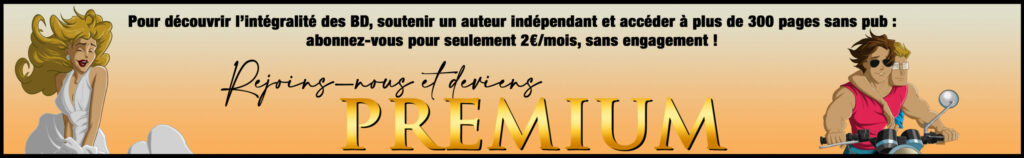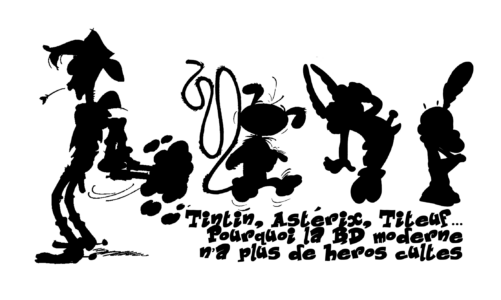Chaque BD de “Mes papas & moi” met un sujet en avant et “Au fil des ans” ne déroge pas à la règle.
Dans “Mes papas et moi : au fil des ans”, Mikl Mayer choisit de traiter la question des thérapies de conversion, malgré leur interdiction en France depuis 2022. Cette thématique, présente en toile de fond dans plusieurs épisodes, prend forme à travers le personnage de Catherine, introduite dès le début du récit comme une mère modèle, attentive et bien intégrée dans la communauté scolaire.
Au fil des chapitres, son rôle s’étoffe. Dans la deuxième partie, Catherine se lance en campagne municipale avec une proposition controversée : l’ouverture d’un centre inspiré des thérapies de conversion. Ce projet, bien qu’incompatible avec la législation actuelle, est présenté dans le récit comme le reflet de convictions profondes. Plus tard, dans la cinquième et dernière partie, nous découvrons que Catherine a été elle-même patiente d’un centre informel, encore actif malgré l’interdiction. Elle y reste impliquée, dans un cadre discret.
Les thérapies de conversion, telles qu’elles sont suggérées dans la bande dessinée, regroupent diverses pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Dans la réalité, ces méthodes peuvent inclure des retraites religieuses intensives, des consultations pseudo-thérapeutiques, ou encore des formes de pression sociale et familiale. Bien qu’elles ne relèvent pas d’un cadre médical reconnu, elles sont souvent présentées comme des “accompagnements” vers une supposée norme, avec des conséquences psychologiques lourdes pour ceux qui y sont soumis.
Dans la fiction, Catherine incarne cette tension entre trajectoire personnelle et engagement idéologique. Son positionnement n’est pas traité de façon manichéenne : il s’inscrit dans une continuité de personnages chez Mikl Mayer qui évoluent dans des cadres familiaux ou sociaux chargés de normes implicites. Son passé de patiente permet aussi d’illustrer comment ces pratiques peuvent être internalisées, jusqu’à devenir des convictions portées à leur tour.
 |
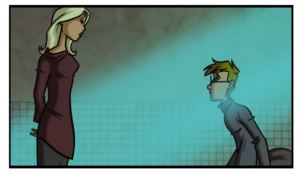 |
 |
En choisissant de mettre en scène ce sujet au sein d’un récit centré sur la parentalité, les relations et la transmission, Mikl Mayer explore les mécanismes sociaux de reproduction des normes. La BD ne cherche pas tant à dénoncer qu’à montrer comment certaines idées peuvent perdurer à travers des histoires individuelles, même dans une société qui semble évoluer vers plus d’égalité. Elle interroge ainsi les décalages entre les lois et les mentalités.
Ce choix d’inclure les thérapies de conversion dans un cadre fictionnel peut également être lu comme un moyen de préserver la mémoire d’une réalité qui, bien que désormais illégale, a existé et continue, parfois, d’exister dans l’ombre. Cela rappelle que les changements juridiques ne s’accompagnent pas toujours d’un changement immédiat des comportements. La fiction devient alors un outil pour maintenir la vigilance collective.
L’introduction de cette thématique s’inscrit dans une tendance de la bande dessinée contemporaine à aborder des sujets complexes à travers le prisme du quotidien. Ce faisant, Mikl Mayer donne une place à des récits rarement explorés dans des formats aussi accessibles, et contribue à ouvrir la discussion sur des pratiques encore mal connues ou minimisées.
Enfin, en intégrant ces éléments à une série centrée sur la famille et les liens intergénérationnels, “Mes papas et moi : au fil des ans” interroge aussi la transmission des valeurs. Le personnage de Catherine est à la fois le produit de son époque et un acteur de perpétuation de certains modèles. À travers elle, la BD montre comment une expérience personnelle peut se transformer en discours politique ou idéologique, avec un impact concret sur les autres.
Découvrez “Mes papas & moi : Au fil des ans” ici